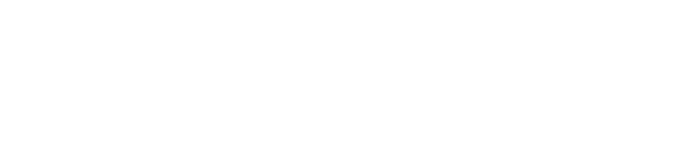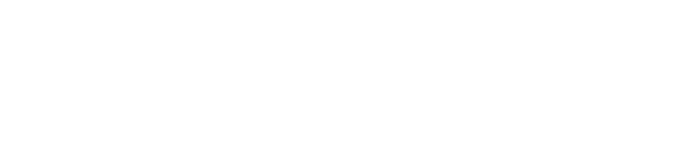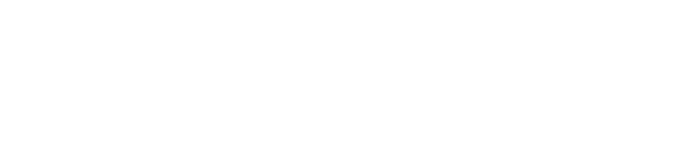L’histoire des relations entre œuvres d’art et espace public depuis les années 1950 n’en finit pas de souligner la différence entre les conditions de l’invention artistique et celles offertes par l’espace urbain.
Ce dernier est collectif, de plus en plus marqué par une fonctionnalité globale et le souci d’une rentabilité marchande; or, la pratique artistique définit un espace toujours singulier,
synonyme de « liberté » et de critique potentielle de toutes les normes admises.
Au début du siècle, la ville offre des lieux propices à l’exaltation des valeurs que reconnaît ou s’attribue la collectivité: se multiplient bustes et statues équestres, allégories et monuments civiques. Après la Première Guerre mondiale, toute ambition artistique s’efface des monuments aux morts, tandis que l’art de la statuaire perd progressivement sa pertinence idéologique.
Le second conflit mondial rend urgente, à travers toute l’Europe, une reconstruction dont normes et matériaux entraînent la médiocrité architecturale.
Ce contexte suscite deux attitudes: certains artistes évoquent - comme l’ont fait trente ans avant eux Mondrian, Le Corbusier ou les enseignants du Bauhaus - «une intégration des arts» apportant à l’architecture le «supplément d’âme» (la dimension esthétique) qui lui fait défaut; d’autres attaquent de front la pratique architecturale et la gestion urbaine contemporaines.
Ainsi, entre 1955 et 1966, les propositions d’architectes-plasticiens (François Stahly, André Bloc, Claude Parent, Nicolas Schöffer) explorent un univers formel susceptible de constituer un bénéfique «cancer dans la cité fonctionnaliste».
En 1961, Schöffer réalise à Liège sa Tour spatio-dynamique sonore, puis il élabore son projet de ville cybernétique. Un peu plus tard, les représentants de l’art cinétique - Agam, Vasarely - ou optique - Cruz Diez - sont prêts à décliner, dans le monde entier et sur tous les registres du décoratif à format variable, leurs propositions colorées. En Autriche, Hundertwasser en appelle à la moisissure «contre le rationalisme de l’architecture», et Constant et Jorn, issus du mouvement Cobra, fondent en 1956 le Mouvement pour un Bauhaus imaginiste, que le premier prolonge par les plans utopiques de sa New Babylon irrationnelle. De tels débats révèlent l’impossibilité, pour les sociétés d’après-guerre, de se rassembler autour d’un nouveau «grand récit» totalisateur.
Ne font - durablement - exception que les sociétés «communistes»: en Union soviétique et dans les démocraties «populaires», ultérieurement en Chine maoïste, la statuaire continue à commémorer les héros «positifs» et à illustrer les slogans officiels.
C’est sans problème que les monuments de bronze ponctuent places publiques, parcs et avenues: interchangeables, ils n’ont d’autre style que le «réalisme socialiste» - et témoignent d’un étouffement durable de la création artistique.
Il n’en va pas de même dans les pays occidentaux, bien que le supplément d’âme espéré s’y solde lui aussi, à quelques exceptions près, par un échec esthétique.
Jusqu’à la fin des années 1960, les initiatives les plus heureuses viennent non des institutions, mais de collectivités locales ou d’investisseurs privés. En 1957, Mathias Goeritz réalise à Mexico son Chemin de Sculptures monumentales; en 1966, une sculpture de Pablo Picasso (20 mètres de haut) est acquise par le Chicago Civic Center et, de 1970 à 1972, un Groupe de quatre Arbres (12 x 10 mètres) est réalisé par Jean Dubuffet pour la Chase Manhattan Plaza de New York.
Encore ces deux derniers exemples ne sont-ils que des sculptures «agrandies».
C’est pourtant au moment de leur mise en place que la sculpture passe, avec le land art (Michael Heizer, Walter de Maria, Robert Smithson) et le minimalisme (Carl Andre), du statut d’objet
«à voir» à celui d’espace à vivre ou d’expérience particulière dans et avec l’espace.
Bien que les artistes du land art aient travaillé prioritairement à l’écart des zones urbaines, la diffusion de leurs travaux modifie profondément la relation entre architecture et œuvre artistique. On en vient à admettre que l’artiste revendique son propre espace - même s’il doit contester celui de l’architecte.
Les œuvres issues de l’appel d’idées lancé en 1974 pour la Défense ne consistent plus –
comme c’est le cas pour Miró ou Calder - à «meubler» un lieu vacant avec des sculptures:
elles confrontent l’espace architectural avec d’autres espaces: celui du cosmos (La Carte du Ciel de Jean-Pierre Raynaud sur le toit de la Grande Arche), celui d’une géométrie virtuelle et d’une nature absente (Place Pascal de Kowalski), celui, aléatoire, de la circulation automobile dans d’autres quartiers (Signaux lumineux de Takis). Semblablement, les colonnes des Deux Plateaux de Buren au Palais-Royal à Paris en 1986, commandées cette fois par le ministère de la Culture, exaltent par leur rythme celui de l’architecture classique en suggérant un rapport fécond de ressemblance-différence. Ni objets ni monuments, de telles œuvres affirment leur autonomie en respectant celle de l’architecture - à condition qu’elle existe. Quand l’architecture fait défaut, la collectivité peut toujours inviter un peintre à occuper une façade aveugle. Les «murs peints» qui se multiplient, tant aux États-Unis qu’en Europe, depuis la fin des années 1960, ne se justifient plus par des enjeux politiques (muralisme mexicain) ou des préoccupations sociales (commandes de la Works Projects Administration américaine): ils sont des «cache-misère» ou, au mieux, des occasions offertes à des artistes d’exposer durablement leur imaginaire - la relation avec l’architecture ou l’urbanisme est inexistante. Tout autre peut être la signification des graffitis new-yorkais envahissant les espaces de circulation (métro, façades, vitrines) au début des années 1970: la signature revendique un territoire subjectif dans l’espace anonyme de la mégalopole - quoique les graffitistes (Futura 2000, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat) aient vite abandonné la rue pour entrer dans les galeries d’art... L’œuvre contemporaine, parce qu’elle propose l’expérience de son espace particulier, peut accéder à des dimensions nouvelles. Lorsque Gordon Matta-Clark découpe des immeubles condamnés, son travail de sculpteur (à formation d’architecte) révèle des formes et des circulations insoupçonnées: le bâtiment devient sculpture. À l’inverse, la sculpture devient espace urbain tant chez Marta Pan (œuvres flottantes dans les parcs japonais, rue de Siam à Brest) que dans les propositions symboliques de Dani Karavan (Axe majeur de Cergy-Pontoise, Colonnade des Droits de l’homme de Nuremberg). L’espace sculptural est, comme celui de l’architecture, espace à explorer, à parcourir, où intervient le corps du citadin. Après l’effondrement des «grands récits», l’œuvre inscrit dans l’espace public des îlots de cohésion ou de sociabilité possible. L’art public reste sans doute contradictoire dans ses termes, en raison de la diversité des publics, des goûts et des tendances artistiques, mais il semble admis que sa «commande» laisse à l’artiste toute liberté d’invention pourvu que les multiples intentions (du commanditaire, de l’artiste, du public futur) se rejoignent d’une façon ou d’une autre. La quasi-impossibilité du monument contemporain est due, simultanément, à l’absence de thème collectivement commémorable et aux transformations de l’expression artistique. L’œuvre peut cependant demeurer signifiante - et dans un espace collectif - jusque dans le mouvement de son retrait ou par son invisibilité. Le Monument contre le fascisme (Harburg) conçu par Esther et Jochen Gerz, lourde colonne accueillant inscriptions, témoignages et agressions des passants, s’est aujourd’hui totalement enfoncé dans le sol, ne laissant derrière lui qu’un souvenir. À la commémoration triomphante se substitue un complexe travail d’anamnèse: sous les pavés de la Platz des Unsichtbaren Mahnmals à Sarrebruck (Allemagne), Jochen Gerz a fait graver le nom des cimetières juifs d’Allemagne. Rien n’est visible pour le promeneur, sauf s’il lit le panneau où est décrit le travail mené; c’est alors la mémoire, ou le temps, qui vient perturber l’espace public. Il est vrai que ce dernier paraît capable d’inclure les objets - architecturaux ou artistiques - les plus hétérogènes, alors que la temporalité serait par nature rebelle à toute harmonisation lénifiante.